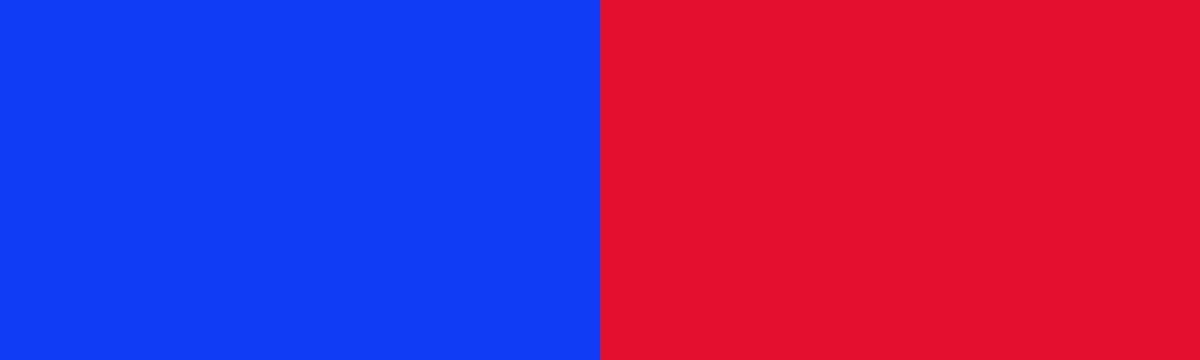Duo formé de Monic Brassard et Yvon Cozic, COZIC présentait sa plus récente exposition à La Maison de la culture de Longueuil du 1er octobre au 22 décembre 2016. Ayant pour titre Un étonnant voyage, cette exposition souhaitait montrer un aperçu de votre parcours qui s’est développé depuis les années soixante. À quoi pouvaient s’attendre les spectateurs ?
Cozic : En invitant COZIC à exposer, La Maison de la culture de Longueuil voulait rendre hommage à nos cinquante ans de création. Travail de coopération complémentaire, au début, qui lentement, à notre insu, a fait naître COZIC, artiste virtuel à la fois création, créature et signature. Une intervention extérieure accueillait les visiteurs. L’exposition se tenait dans trois salles. Dans une première salle, nous avons remonté une exposition de 1978, ayant pour titre Réflexions sur une obsession, qui regroupe un ensemble d’œuvres réalisées en relation formelle avec un origami redécouvert en 1975 : la cocotte de papier. Ces dessins, peintures, sculptures sont un véritable catalogue des techniques et des matériaux variés qui étaient pertinents à cette époque et qui sont encore le ferment des créations de COZIC. Dans la deuxième salle, Un étonnant voyage était exposée avec une œuvre participative, Les orphelins de 1973, et rappelait au visiteur un aspect de notre travail, présent depuis les années soixante, concernant la manipulation des œuvres comme moyen de perception. L’accompagnaient cinq œuvres installées au sol et aux murs affirmant, dans une partie de leur confection, cette constance pour les matériaux et les techniques utilisées dans les œuvres de la première salle. Les cinq œuvres de 2015-2016 qui s’y trouvaient également témoignent de notre intérêt pour la nature et un questionnement sur ses mystères. Dans la troisième salle, cozic en action présentait en boucle trois vidéos de performances : Le requin de la fine nuance et la souris tamponneuse (2004), Le lancer du mikado (2006) et Les onomatopées (2008). Le spectateur pouvait retrouver exposés les accessoires de chacune des performances. Les performances ont ponctué la carrière de COZIC depuis les années soixante-dix. Ces brefs évènements artistiques sont devenus un rituel lors des vernissages. Nous avons utilisé cette forme d’art pour inviter le public à vivre le moment présent avec l’œuvre et l’artiste. Au sortir des salles, une grande bannière en papier de soie stratifié accompagnait le visiteur dans sa montée-descente dans la cage de l’escalier.
Comme « sculpteur », COZIC s’intéresse à des matériaux de la culture populaire : papier, carton, tissu, peluche, bois, etc. Ainsi, COZIC crée des œuvres qui semblent refuser l’aspect sacré que l’art, parfois, tente d’insuffler à des objets culturels. Vous souhaitez même que les spectateurs touchent, manipulent vos œuvres, considérant que c’est ainsi que l’expérience esthétique sera complète puisque plusieurs de vos œuvres ne sont pas réservées au seul sens de la vue. Cette attitude d’artiste participe d’un courant, d’un mouvement. Y a-t-il, de votre part, des influences artistiques qui vous ont marqués au début de votre démarche ?
Opter, choisir d’utiliser des matériaux de la culture populaire pour la réalisation de nos œuvres n’est pas récent, mais présent depuis notre passage à l’école des beaux-arts de Montréal au début des années soixante. Papier, carton, tissus variés, peluche, bois, plumes provoquent, par leur emploi, un questionnement, une curiosité sur le détournement de sens qui découle de leur utilisation. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas leur provenance, mais ce qu’ils nous inspirent. Nous qualifions ces matériaux privilégiés de non–nobles. Nous créons entre ces matériaux des rencontres impossibles sans notre intervention, le résultat : faire voir l’improbable. L’aspect sacré, prodigué à des objets culturels, leur est acquis parce qu’ils sont liés à une activité sacrée (ex. : considérer l’Art comme une religion). Par les matériaux que nous privilégions, nous interrogeons le travail du temps sur la matière, la pérennité des œuvres. Notre détournement du conventionnel en pratique artistique reste une attitude fondamentale.
Pourquoi cette tyrannie de la vue, depuis des siècles, pour accéder à une appréciation de l’œuvre d’art ? De tous nos sens, la vue est le plus intellectuel, donc le mieux desservi par les mots. Il est établi aujourd’hui que la vue n’est pas l’unique moyen pour percevoir le monde réel, nous l’appréhendons par tous nos sens. Nous avons utilisé le toucher, dès la fin des années soixante, pour mettre le spectateur en situation d’être un acteur. En prenant tactilement contact avec les matériaux, la peluche notamment, des souvenirs personnels, des sensations oubliées resurgissent et participent à la compréhension de l’œuvre. De plus, en manipulant les matériaux que nous avons nous-mêmes manipulés, le spectateur se rapproche du moment de la création. Le tactile est un jeu avec la matière. Toucher certifie ce que l’on voit.
Nous ne pensons pas être des artistes sous influence. Nous avons découvert certains mouvements artistiques au moment où nous exprimions, dans nos productions, une « arttitude »semblable. Le fait de vivre dans des systèmes sociétaux similaires engendre des réactions similaires; il n’est donc pas surprenant que des recoupements ponctuels, dans leur production, se rencontrent chez des artistes n’ayant aucun lien autre. Il n’y a pas de génération spontanée. Nous ne nous reconnaissons pas d’influences admiratives particulières qui auraient marqué le début de notre démarche. Démarche qui a permis la lente mise au monde de COZIC.
Vous avez mentionné, plus haut, l’importance des performances qui ont ponctué votre parcours artistique depuis les années soixante-dix. Cette façon de faire, celle d’intégrer une activité qui place COZIC en chair et en os au sein d’une œuvre, participe sans doute aussi de votre vision de l’art. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
Ce que l’on appelle aujourd’hui performance serait une suite de ce que l’on appelait, dans les années soixante, happening : actions spontanées, improvisées qui naissaient lors des rencontres entre artistes au public restreint. La performance est devenue pour nous une activité complémentaire aux expositions. Souvent faites lors du vernissage, elles donnent le ton à l’exposition, établissent une atmosphère qui met dans l’ambiance et, ensuite, orientent la lecture des œuvres. Le fait de nous mettre en scène établit une connivence, une intimité avec le spectateur, lui permet de mieux nous connaître pour ensuite mieux nous retrouver à travers nos œuvres. La première performance répertoriée est Les 19 premiers jours de la vie d’Eustache en 1972. Le soir de l’ouverture de l’exposition, Eustache, petit cylindre de peluche bleu azur tapi dans un nid de vinyle bleu pâle suspendu aux quatre coins de la galerie, était mis au monde et présenté au public. Ensuite, tous les trois jours, il doublait de volume pour atteindre les limites de la galerie et mourir d’asphyxie après 19 jours. Le public était ainsi invité à assister à sa transformation tous les trois jours. Une façon d’inciter les gens à visiter plusieurs fois une exposition puisqu’à chaque fois, si ce n’est les œuvres qui changent, les personnes changent, et la perception est différente. Les 19 premiers jours de la vie d’Eustache, c’est en fait une performance qui a duré 19 jours. De Eustache… à La souris tamponneuse et le requin de la fine nuance, en 2004, qui a duré une minute, le temps est un élément composant, et son but, toujours le même, est de mobiliser l’attention du spectateur, de le retenir puisqu’il semble que la moyenne de temps que passe une personne devant une œuvre, dans les musées, est de 13 secondes.
Lors de l’exposition dont il est question au début de cet entretien, aucune référence n’est faite au projet qui vous a tenu en haleine pendant plusieurs années, je veux parler de code Couronne. Ce projet qui repose sur l’idée de décoder la couleur des mots a débuté, sauf erreur, en 2008, lors d’une exposition qui s’est tenue à Expression (Saint-Hyacinthe). Comment celui-ci, qui s’est poursuivi jusqu’à tout récemment, s’insère-t-il dans votre esthétique d’artiste ?
Enfants, nous utilisions des codes secrets pour communiquer entre amis. Dès le début des années soixante, les lettres apparaissent dans nos peintures et nos sculptures. Cette insertion lettriste continuera, par la suite, à figurer sporadiquement dans nos œuvres surtout pour la qualité graphique des lettres, ce qui nous a amenés à nous intéresser aux différents codes (maritime, braille, morse, sémaphore, entre autres) afin de réaliser des œuvres-signatures. Au début des années 2000, nous inventons un alphabet visuel et coloré nommé Code Couronne d’après la forme de ses lettres. Cet alphabet nous permet de créer des peintures, des dessins, des sculptures en écrivant des mots, des phrases qui, au-delà de leur forme plastique, peuvent être traduits et soit amenés à une nouvelle interprétation de l’œuvre, soit en compléter le sens. La première présentation de ce Code Couronne fut faite lors de deux expositions en 2008 : Lire et écrire la couleur, à la galerie Graff de Montréal, et L’Art c’est faire du bruit en silence au centre d’exposition Expression de Saint-Hyacinthe. Chez Graff, l’exposition regroupait peintures, dessins, gravures, sculptures et de l’installation. Lors du vernissage, une première expérience de sonorisation du Code Couronne fut exécutée. À Expression, 50 grands dessins traduisaient en Code Couronne des onomatopées associées à des titres de journaux sur différentes situations de la vie sociale. Le soir du vernissage, une performance jumelait lecture et mime de ces onomatopées. Depuis sa sonorisation, le code a évolué vers une musicalisation plus complexe qui a débouché sur des performances multidisciplinaires appelées Code Couronne en synesthésie. Ces performances regroupent le travail du musicien/informaticien Claude Frascadore, du poète Jean-Paul Daoust et des projections en Code couronne animées par Nadja Cozic, le tout mis en scène par COZIC, bien sûr, et interprété au piano par Jonathan Nemtanu.
Le Code Couronne n’a pas fini sa trajectoire, il est riche de possibilités; musicalement, il évolue vers l’orchestration. Toute l’aventure du Code Couronne s’inscrit parfaitement dans notre démarche : l’idée du travail sériel, l’idée de s’adresser à plusieurs sens à la fois, de multiplier les disciplines au sein d’une même œuvre et de recourir à la participation du regardeur.
Dans ce parcours d’une grande cohérence, en effet, il y a aussi La Société Protectrice du Noble Végétal que vous avez fondée, au début des années soixante-dix, et qui semble l’occasion, pour COZIC, de rassembler artistes et ami.es en vue de partager votre goût pour le jeu, et l’esprit du jeu. Ai-je raison ?
Nos premières incursions dans le cadre nature furent réalisées au début des années soixante-dix avec Corde à linge. Sur la corde à linge domestique, nous exposions une série colorée de bandelettes de papier de soie qui subissaient, jusqu’à leur disparition, les effets du soleil, de la pluie et du vent. Cette réflexion sur la pérennité des œuvres reste constante depuis. L’expérience des Cordes à linge fut reprise lors de notre participation à La Biennale des jeunes de Paris, en 1971, en tant que représentant du Canada, puis au Festival international d’art contemporain de Royan, en 1972, comme représentant du Québec. C’est alors qu’est née La Société Protectrice du Noble Végétal qui, dès lors, chapeauta nos interventions dans et avec la nature (Vêtir ceux qui sont nus, Greffes implants et marquages, Néo-Nymphéas, Le train ne siffle plus à cette intersection, entre autres). Ces actions, en attirant l’attention sur la protection de la nature, ne sont pas sans faire référence à l’humain, ce noble végétal, ce roseau pensant de Pascal, mis dans des situations, des contextes souvent ironiques, mais qui n’en appellent pas moins à la réflexion. Le titre de Société Protectrice du Noble Végétal, et son rôle de sponsor de certaines de nos interventions artistiques, est lui-même un clin d’œil à tout ce protocole, toutes ces permissions, tous ces appuis dont a souvent besoin l’artiste pour produire et qui, au-delà d’une aide, sont souvent une contrainte et même une restriction à la liberté de création. Il y a des limites partout, mais nous préférons nous les imposer nous-mêmes; tout ça, bien sûr avec un certain sourire.
De plus, toujours sous l’égide de La Société du Noble Végétal, deux événements ont été organisés : Implants greffes et marquages, en 2004, et Un dimanche à la campagne en 2014. Réalisés sur le terrain autour de l’atelier, ils furent l’occasion, pour nous et une quinzaine d’artistes invités, de réaliser des œuvres dans un contexte nature et une invitation ouverte au public à passer une journée à la campagne avec pique-nique, balades en forêt, visite du travail des artistes, récital de poésie sous les pommiers, interprétation de la botanique locale, etc… prétexte de partager avec artistes et ami.es l’esprit « Cozicien ».
Lors de la parution du premier numéro de la revue ESPACE, en 1987, votre pratique était déjà bien ancrée dans le paysage artistique québécois. Par la suite, et après de nombreux prix et distinctions, vous êtes toujours présents, comme en fait foi cet entretien. Par ailleurs, depuis 2014, avec les numéros 107 et 108, la nouvelle direction de la revue a souhaité donner un nouveau souffle à sa mission éditoriale en entreprenant un dossier ayant pour thème « re-penser la sculpture ? », comment situez-vous votre pratique par rapport à cette question ?
La sculpture se définissait, jusqu’à récemment, comme une activité artistique consistant à concevoir et à réaliser des formes; en volume, en relief, en ronde-bosse (statuaire), en haut et en bas-relief, par modelage, par la taille directe, par soudure ou assemblage. Pour réaliser une sculpture, aujourd’hui, toutes ces techniques se conjuguent, se combinent entre elles. Comme dans toutes les autres expressions artistiques, nous avons assisté à un décloisonnement, à un éclatement des frontières qui définissaient si bien chacune des disciplines. Le mot sculpture semble désuet, insatisfaisant pour exprimer les nouvelles formes d’inscription dans l’espace. Musées, galeries, espaces publics; quel que soit l’endroit où elle s’exprime, la performance, l’art in situ, l’installation ont imprégné la « sculpture » qui se fait plus théâtrale, plus spectacle. Les nouvelles technologies ont déjà et auront aussi leur influence. Bien sûr, les techniques mentionnées au début sont toujours reconnaissables, en particulier dans l’art public, à cause de la pérennité exigée des œuvres, mais la technique n’est plus un but en soi, mais un moyen; le but recherché semble plus être le spectaculaire, le divertissement.
Pour ce qui est de notre inscription en sculpture, il semble que, dès le départ, il y a eu ambiguïté : le nom de sculpture a été attribué à notre travail faute d’autre terme plus adéquat; « objets à trois dimensions » aurait peut-être été plus juste. Déjà, à la fin des années soixante, avec l‘utilisation des matériaux non traditionnels, de la mise en scène de nos expositions que l’on appelait alors environnement, de l’invitation faite au public à manipuler les œuvres, nous étions dans cette mouvance qui a mené à repenser la sculpture. Nous sommes toujours aussi à l’aise dans ce mouvement. On ne peut pas prévoir et annoncer ce que sera la sculpture; seuls ceux et celles qui la font construisent progressivement son avenir.
COZIC, Boudin Impérator, 1968. Photo : Robert Binette.
COZIC, Ground Pliage 6 : Remora Amore, 1980. Photo : Daniel Roussel.
COZIC, Performance Le lancer du mikado, 2006. Photo : Guy L’Heureux.
COZIC, A cocotte a day keeps the obsession on the way, 1978. Photo : Daniel Roussel.
COZIC, Corridart: Cross-country, 1976. Photo: Daniel Roussel.
COZIC, Éclosion, 2011. Photo : Hélène Vanier.
COZIC, Le trou noir, 2016. Photo : Alexandre Sergejewski.
COZIC, Par En Thèse, 2012. Photo : Daniel Roussel.
COZIC, Pelote faux-foin, été 2014. Photo : Daniel Roussel.
COZIC, Réflexions sur un atoll : pourquoi Vuitton, 1994. Photo : Denis Farley.
COZIC, Tétraktys, 2004. Photo : Daniel Roussel.